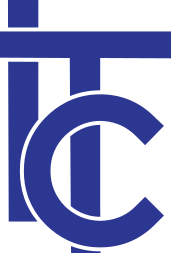Les fondations sont la base de toute construction. Elles garantissent la stabilité et la durabilité du bâtiment, en répartissant les charges de la structure dans le sol. Pourtant, toutes les fondations ne se valent pas.
Leur conception dépend d’un critère essentiel : la nature du sol. Sol argileux, sableux, rocheux ou remblayé… Chaque terrain nécessite une solution spécifique.
Pourquoi adapter les fondations au sol ?
Avant même de poser la première pierre, il est impératif de comprendre le comportement du sol. Un sol mal analysé peut provoquer des affaissements, fissures, ou même des glissements de terrain à long terme.
L’étude de sol, souvent réalisée par un bureau de géotechnique, permet de mesurer :
- La portance du terrain,
- La profondeur du sol stable,
- Les risques de retrait-gonflement,
- La présence d’eau ou de remblais.
En fonction de ces éléments, on peut choisir entre des fondations superficielles, semi-profondes ou profondes.
Les fondations superficielles : pour les sols portants et homogènes
Les fondations superficielles, aussi appelées fondations directes, sont posées à une profondeur généralement inférieure à 2 mètres. Elles conviennent aux terrains homogènes, non compressibles, offrant une bonne portance dès la surface.
Les semelles filantes
C’est le type le plus courant pour les maisons unifamiliales. On coule une semelle de béton armé sous les murs porteurs afin de répartir les charges. Ce système est rapide, économique et bien adapté aux sols durs ou légèrement argileux.
Les semelles isolées
Elles sont utilisées sous des poteaux ou des points de charge ponctuels. Plus épaisses que les semelles filantes, elles nécessitent un ferraillage précis.
La radier général
Le radier est une grande dalle en béton armé couvrant toute la surface du bâtiment. Il est privilégié lorsque le sol est peu résistant mais homogène, ou quand les charges à supporter sont élevées. Il peut également servir dans les zones inondables ou avec nappe phréatique proche.
Les fondations semi-profondes : quand le bon sol est plus bas
Si la couche de sol résistant se situe à une profondeur intermédiaire (entre 2 et 6 mètres), on opte pour des fondations semi-profondes. C’est souvent le cas dans les zones urbaines ou en rénovation.
Les puits
Ce sont des cavités circulaires ou carrées forées jusqu’à la bonne couche de sol, puis remplies de béton. Chaque puits est relié par une longrine (poutre horizontale) qui répartit les charges entre eux.
Les massifs
Variante du puits, le massif est un bloc de béton plus volumineux, utilisé lorsque la structure impose une large zone d’appui.
Ces fondations sont plus complexes à mettre en œuvre que les superficielles, mais restent accessibles pour les petits immeubles ou bâtiments industriels.

Les fondations profondes : pour les terrains instables ou compressibles
Lorsque le sol superficiel est trop meuble, compressible ou hétérogène, on doit aller chercher la stabilité en profondeur. Les fondations profondes assurent le transfert des charges à des couches géologiques plus solides, parfois à 10, 20 voire 30 mètres de profondeur.
Les pieux
Les pieux sont des éléments cylindriques (béton armé, acier ou bois) forés ou battus dans le sol. Il en existe plusieurs types :
- Pieux forés : le sol est foré, puis rempli de béton et armature. Utilisé en zone urbaine pour limiter les vibrations.
- Pieux battus : enfoncés par percussion dans le sol. Méthode rapide mais bruyante, à éviter près d’habitations existantes.
- Micropieux : adaptés aux terrains difficiles ou en rénovation, avec des diamètres plus petits (moins de 300 mm).
Les barrettes ou parois moulées
Pour les très grands projets (tours, infrastructures souterraines), on utilise des fondations par parois moulées, creusées verticalement puis bétonnées. Ce système complexe garantit une résistance exceptionnelle.
Adapter les fondations selon les types de sol
Chaque type de sol a ses particularités qui influencent directement le choix des fondations.
Sols argileux
Ils sont sensibles au phénomène de retrait-gonflement, en fonction de l’humidité. Il est conseillé d’ancrer les fondations sous la zone affectée, avec des semelles plus profondes ou un radier renforcé.
Sols sableux
Stables s’ils sont bien compactés, mais sensibles aux ruissellements. Les semelles filantes fonctionnent bien, mais attention aux affouillements par l’eau.
Sols remblayés
Instables par définition, car constitués de matériaux rapportés, parfois hétérogènes. On optera souvent pour des pieux ou un radier flottant si le remblai est important.
Sols rocheux
Excellente portance. Les semelles superficielles sont largement suffisantes. Le principal défi est le terrassement, plus coûteux.
Sols avec nappe phréatique
L’eau peut fragiliser les sols et compliquer le bétonnage. Un radier étanche ou des fondations profondes sont à privilégier.
L’importance de l’étude de sol
Trop souvent négligée, l’étude de sol (type G2 AVP ou G3 pour les projets de plus grande envergure) permet d’anticiper les problèmes structurels. Elle fournit des recommandations précieuses sur la profondeur, les techniques à privilégier, et les éventuels renforts à prévoir.
Son coût (de 1000 à 3000 euros selon la complexité) est vite rentabilisé lorsqu’on considère les risques d’un affaissement, de fissures ou d’instabilité du bâtiment.
Les points à retenir
Le choix du type de fondation n’est jamais arbitraire. Il dépend étroitement des caractéristiques du terrain, de la charge du bâtiment, et des contraintes environnementales. De la semelle filante au pieu profond, chaque solution a ses avantages techniques et économiques.
Pour garantir la pérennité de toute construction, faire appel à un professionnel du gros œuvre et suivre les recommandations d’un géotechnicien est une étape essentielle. Une fondation bien choisie, c’est la garantie d’un bâtiment stable pour des décennies.